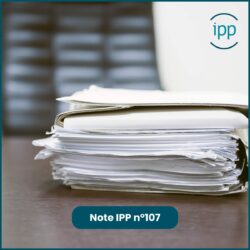> Lire la note
Cette version a été mise à jour le 27/11/2024 avec des ajouts de précisions méthodologiques.
Copier
Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France. Maëlle Stricot. Avril 2024. Note IPP n°107.
Présentation
Malgré la prise de conscience collective suscitée par la vague #MeToo en octobre 2017, les violences faites aux femmes demeurent fréquentes. Dans un contexte de libération de la parole et de mobilisation accrue des pouvoirs publics, les affaires de violences sexuelles et conjugales portées à la connaissance de la justice n’ont jamais été aussi nombreuses. La réponse apportée par le système judiciaire à l’encontre de
ces violences soulève toutefois des interrogations et des débats. Cette note cherche à apporter de nouveaux éclairages sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes et son évolution au cours du temps.
Résultats clés
- Cette note s’appuie sur des données administratives inédites sur la vaste majorité des
affaires pénales traitées par les parquets, classées sans suite ou terminées en première
instance au tribunal correctionnel ou en juridiction pour mineurs entre 2012 et 2022,
hors non-lieux et renvois en cours d’assises et cours criminelles suite à l’instruction. - Le nombre d’affaires de violences sexuelles et conjugales traitées par la justice a connu
une forte hausse depuis 2017, marquée par l’augmentation de l’enregistrement de faits
anciens. - Comme pour la plupart des infractions pénales, le taux de non-poursuite est élevé et
concerne 83 % des violences sexuelles et 73 % des violences conjugales. Pour les autres
infractions d’atteintes à la personne, ce chiffre est de 84 %. - Les violences sexuelles et conjugales sont principalement considérées comme insuffisamment caractérisées par le parquet et classées faute de preuves. Cela se distingue
des autres infractions pénales, qui sont majoritairement classées sans suite car l’auteur
est inconnu. - Les auteurs qui sont poursuivis sont souvent condamnés, avec des peines plus lourdes
pour les violences sexuelles que pour les autres atteintes à la personne. - Alors que la part d’affaires de violences conjugales non poursuivies est passée de 73 %
en 2012 à 67 % en 2019, une tendance inverse s’observe pour les violences sexuelles.
La part des agressions sexuelles non poursuivies est ainsi passée de 80 % à 83 %. - La hausse des poursuites des auteurs de violences conjugales s’est accompagnée d’une
plus grande sévérité des peines d’emprisonnement prononcées à leur encontre.
Cette version a été mise à jour le 27/11/2024 avec des ajouts de précisions méthodologiques.
> S’abonner pour recevoir les futures actualités et publications du pole Police-Justice de l’IPP
Méthode et données
Les données utilisées pour cette étude proviennent du logiciel de gestion CASSIOPÉE. Ce logiciel est utilisé par les juridictions pour traiter toutes les infractions relatives à des contraventions de cinquième classe, des délits et des crimes, reprochés à des personnes physiques (majeurs et mineurs) ou à des personnes morales, dont les informations sont principalement renseignées par les greffes des tribunaux.
Les données extraites du fichier statistique CASSIOPÉE par le ministère de la Justice fournissent des informations sur toutes les affaires pénales reçues par les magistrats, classées sans suite ou terminées en première instance au tribunal correctionnel ou en juridiction pour mineurs entre 2012 et 2021.
Cette note constitue ainsi l’une des premières études de recherche à recourir à ces données, venant notamment exploiter leur dimension longitudinale. Les données n’étant disponibles que pour les affaires terminées et non pour celles encore en cours de jugement, elles doivent toutefois être interprétées avec précaution pour les deux dernières années concernant les séries temporelles. Par ailleurs, les données mises à disposition ne couvrent pas les affaires ayant conduit à un non-lieu suite à l’instruction, ni les affaires jugées en cours d’assises ou cours criminelles départementales – qui correspondent néanmoins à une faible part des affaires traitées par la justice pénale en général (Ministère de la Justice, 2019).
Autrice
Maëlle Stricot est doctorante à l’École d’Économie de Paris et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, afilliée à l’Institut des politiques publiques (IPP) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
Partenaire
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’avenir de PgSE (référence ANR-17-EURE-0001) et de l’ANR SOCOCITY (référence ANR-18-CE22-0013) pour le financement du Centre d’accès sécurisé aux données (CASD).
Ce message est également disponible en :  Anglais
Anglais