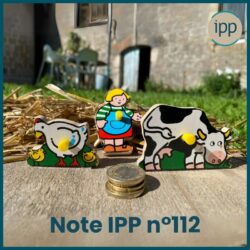> Lire la note
Citer. Prix planchers dans les filières agroalimentaires : une mesure d’efficacité? Note IPP n°112. Rémi Avignon, Etienne Guigue. Décembre 2024.
Présentation
L’idée d’introduire des prix planchers dans les filières agricoles a récemment refait surface dans le débat public. Mesure phare de la Politique Agricole Commune (PAC) des années 1970-1980, les prix planchers ont pourtant été source d’inefficacité et laissé de mauvais souvenirs. Cette note montre cependant qu’un prix plancher sur la matière première peut être source d’efficacité dans les filières où les agriculteurs font face à des acheteurs ayant du pouvoir de monopsone, c’est-à-dire étant capables de peser négativement sur les prix.
Résultats clés
- Si un prix plancher imposé sur un marché concurrentiel est forcément inefficace, un prix plancher sur la matière première peut être efficace dans les filières où les agriculteurs font face à du pouvoir de monopsone.
- Dans la filière lait de vache (non-labellisé biologique ou AOP), nous montrons que les industriels français exercent du pouvoir de monopsone à l’achat de lait cru, acheté à un prix inférieur – en moyenne sur la période 2003-2018 – de 16% à sa contribution marginale à leurs profits.
- Dans de telles filières, un prix plancher indexé sur les cours internationaux des denrées agricoles et prenant en compte les coûts de fabrication des industriels, conduirait à une meilleure rémunération des agriculteurs et à une réduction des marges des industriels à l’achat de matière première.
- L’instauration d’un prix plancher efficace pourrait néanmoins déstabiliser une filière à court terme et renforcer la concentration de son échelon industriel à long terme, rendant incertain son effet sur les prix payés par les consommateurs.
- Le soutien aux revenus agricoles permis par un prix plancher, seul, est limité par la concurrence internationale. Il peut être complété par des mesures de soutien de l’offre agricole (subventions, politique commerciale), dont il améliore l’efficacité en empêchant son transfert vers les acteurs situés en aval des filières.
- Un prix plancher indexé sur les cours internationaux ne permettrait pas le lissage des revenus agricoles, qui pourrait être atteint via l’introduction d’un dispositif assurantiel.
> Lire la note
Méthode et données
L’analyse est basée sur des données au niveau des usines de transformation laitière, où les prix et quantités de lait cru par département côté achats, et par produit côté ventes, sont observés de 2003 à 2018. Les données sont fournies par le Ministère de l’Agriculture (Enquête Annuelle Laitière), FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière), et le Ministère des Finances Publiques (FICUS, FARE, LIFI). L’accès à certaines données utilisées dans le cadre de ce travail a été réalisé au sein d’environnements sécurisés du Centre d’accès sécurisé aux données – CASD (Réf. 10.34724/CASD).
Les auteurs restreignent l’analyse aux produits à base de lait de vache non-labellisé biologique ou AOP. L’estimation des marges est faite en deux étapes.
(1) Estimation des coûts de transformation et des marges
Une approche dite ”fonction de production”, standard dans la littérature (De Loecker etWarzynski, 2012), nous permet d’estimer le coût marginal de transformation du lait cru en produits finis et industriels de chaque entreprise. Associée aux données de matières grasse et protéique contenues dans le lait cru et dans chaque produit laitier (Depeyrot, 2010), et de prix et quantités, cette méthode permet d’estimer les marges sur coût variable des industriels laitiers.
(2) Identification séparée des marges de monopsone et de monopole
L’existence des ingrédients laitiers nous permet ensuite d’estimer séparément les marges de monopsone, appelées markdowns, et de monopole, appelées markups. L’identification est basée sur le fait que ces ingrédients sont :
— des substituts au lait cru côté achats, et des débouchés alternatifs aux produits finis côté ventes,
— échangés à un prix que les entreprises considèrent comme donné.
L’identification repose alors sur les conditions d’arbitrage des industriels lors de leurs décisions d’approvisionnement en lait cru ou ingrédients d’une part, et de production et vente de produits finis ou ingrédients d’autre part. À l’équilibre, les entreprises ayant recours à des ingrédients égalisent le prix des ingrédients (observé) avec les coûts marginaux d’approvisionnement en lait cru (composé du prix du lait, observé, et du coût d’opportunité inversement lié à la markdown, non observé). Symétriquement, les entreprises vendeuses d’ingrédients égalisent le prix des ingrédients (observé) avec les recettes marginales nettes de chaque produit fini (composé du prix du produit fini, observé, et du coût d’opportunité ou markup, non observé). Ces conditions d’arbitrage permettent l’identification séparée des markdowns et markups.
Partenariat
Cette note a bénéficié du soutien de l’Agence Nationale de la Recherche (Programme Investissements d’Avenir, ANR-18-EURE-0005), de l’ERC Consolidator Grant 816638 attribuée à Jan De Loecker, et de l’INRAE.
Étude de référence
Avignon, Rémi et Etienne Guigue (2023). Markups and Markdowns in the French Dairy Market. Rapp. tech.
Ce message est également disponible en :  Anglais
Anglais